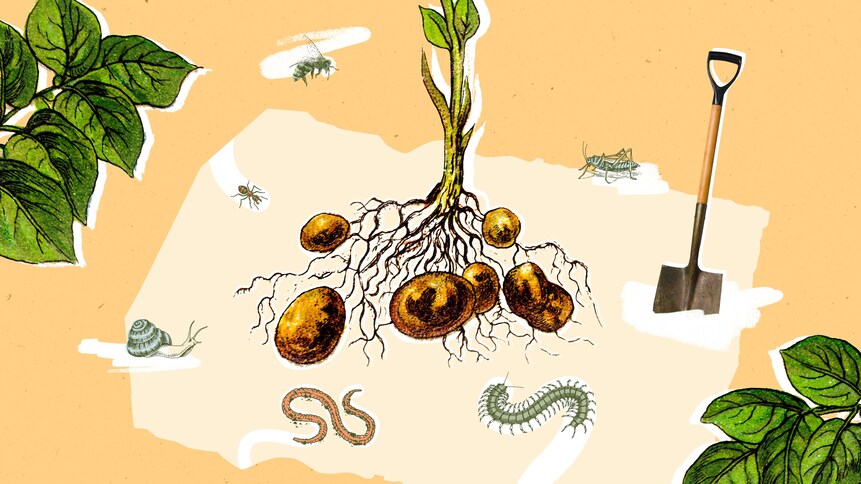La révolution verte du siècle dernier a permis d’augmenter drastiquement la productivité au sein du système agroalimentaire grâce, notamment, aux pesticides et engrais de synthèse, aux variétés à haut rendement, à la machinerie lourde et à l’irrigation des champs. Aujourd’hui, plusieurs enjeux découlent toutefois de l’utilisation de ces technologies, comme la dégradation des sols, la résistance des ravageurs et des maladies aux produits agrochimiques, la perte de la biodiversité… Et si la nature détenait déjà la solution à nos problèmes?
Le duo de nutritionnistes Catherine Lefebvre et Bernard Lavallée anime le balado On s’appelle et on déjeune(Nouvelle fenêtre), où l’on fait part de découvertes liées à l’univers de l’alimentation et discute de sujets qui font réfléchir. À écouter sur Radio-Canada OHdio!
Du champ…
L’agroécologie, comme son nom l’indique, est un domaine qui allie l’agriculture et l’écologie. Cette approche s’inspire des écosystèmes pour produire des aliments(Nouvelle fenêtre) en limitant, voire en excluant, les intrants de synthèse, comme les engrais et les pesticides.
Par exemple, on recycle la matière organique afin d’y retourner les nutriments dont les plantes ont besoin. On peut donc penser aux parties non comestibles des cultures et au fumier.
Contrairement aux engrais de synthèse, qui ne contiennent que quelques nutriments précis destinés aux végétaux, les matières organiques servent également de nourriture aux micro-organismes, qui participent à enrichir la terre. Les sols en santé et pleins de ces matières organiques emmagasinent l’eau plus efficacement, ce qui permet une meilleure résilience contre la sécheresse.
L’agroécologie s’intéresse également à la biodiversité au sein des systèmes de production. Dans un champ de monoculture, où une seule espèce est plantée, la biodiversité est limitée. Ce genre de système peut favoriser la multiplication des insectes ravageurs qui ne font face à aucun prédateur.
À l’inverse, quand on a une grande diversité de plantes, on a aussi une grande diversité d’insectes, […] de bactéries ou de champignons qui finissent par entrer en équilibre les uns avec les autres
, explique Alain Olivier, professeur à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval et auteur du livre La révolution agroécologique : nourrir tous les humains sans détruire la planète.
De cette façon, les champs sont plus accueillants pour les insectes qui participent à la pollinisation et ceux qui gobent les ravageurs, comme les oiseaux, les chauves-souris et les amphibiens. En créant des lieux qui sont favorables à ces animaux, les personnes qui adhèrent à l’agroécologie peuvent protéger leurs champs en utilisant moins ou pas de pesticides.
Ainsi, même si la science s’y intéresse de plus en plus, l’agroécologie repose sur des actions qui ont été répétées par des générations d’agriculteurs et agricultrices (certaines personnes préfèrent les termes paysans et paysannes
) depuis des siècles.
…à l’assiette
Ceux et celles qui cherchent une solution clé en main qu’on peut appliquer partout ne la trouveront toutefois pas dans cette approche. Actuellement, [avec l’agriculture industrielle] on peut avoir les mêmes champs de soya au Paraguay, en France, au Québec et en Indonésie, par exemple, alors que ce sont des contextes complètement différents. En agroécologie, on s’adapte au contexte du sol, du climat, mais aussi au contexte culturel et social, aux habitudes alimentaires où on se trouve, qui ne sont pas les mêmes en Indonésie qu’au Québec
, explique Alain Olivier.
En effet, l’agroécologie vise à s’adapter au contexte afin que les plantes et les animaux inclus dans les systèmes de production fassent réellement partie de l’alimentation des populations locales. Il ne suffit pas qu’une céréale ait un bon rendement pour qu’elle soit plantée et appréciée… Il faut aussi qu’elle ait bon goût!
Miser sur la diversité amène également des bénéfices pour l’alimentation, puisque cela permet aux paysannes et paysans d’être plus résilients contre les imprévus. Par exemple, si le sorgho, une céréale cultivée abondamment en Afrique, produit peu une année à cause du climat, il reste d’autres plantes à manger. Et si le prix du café chute soudainement, le producteur qui a inclus des bananiers à son système pourra toujours vendre quelque chose.
En somme, l’agroécologie rappelle l’importance de réfléchir à l’agriculture et à l’alimentation ensemble, afin de s’assurer qu’on puisse nourrir adéquatement tout le monde, et ce, sans détruire la planète.