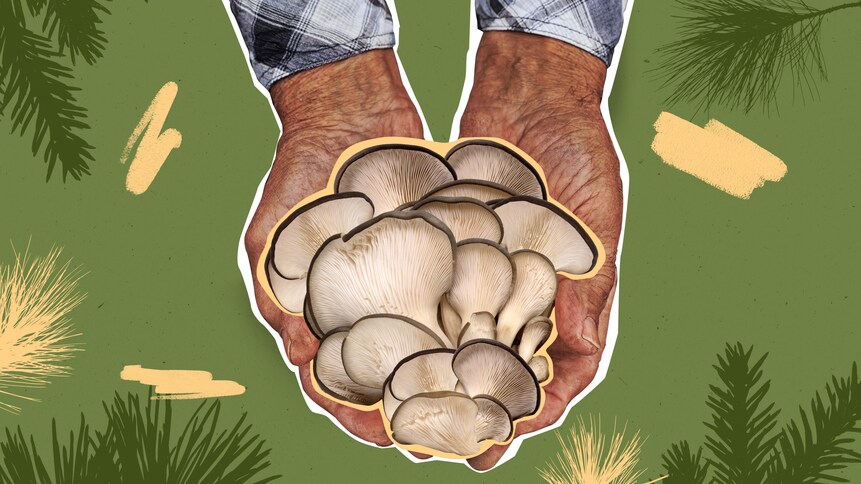Pour la plupart d’entre nous, la culture autochtone était peu abordée dans les cours d’histoire à l’école. On ne connaît donc pas grand-chose des us et coutumes, dont l’alimentation, des différentes communautés qui composent ce que l’on appelle aujourd’hui le Canada. Afin d’entamer la conversation à ce sujet, nous avons joint Melissa Mollen Dupuis, une Innue originaire d'Ekuanitshit, sur la Côte-Nord.
Les nutritionnistes Catherine Lefebvre et Bernard Lavallée animent le balado On s’appelle et on déjeune(Nouvelle fenêtre), où l’on fait part de découvertes liées à l’univers de l’alimentation et où l’on discute de sujets qui font réfléchir. À écouter sur OHdio!
Une question de territoire
Melissa Mollen Dupuis est réalisatrice (Les tributaires du territoire, Nitanish – À ma fille, O…) et cofondatrice de l’antenne québécoise du mouvement Idle No More. Elle anime également l’émission Parole autochtone à ICI Espaces autochtones. Depuis 2018, elle est responsable de la campagne Forêts – un plan d’action pour protéger l’habitat du caribou au Québec — menée par la Fondation David Suzuki.
Pour elle, la nourriture est intimement liée au territoire(Nouvelle fenêtre). L’alimentation traditionnelle autochtone est diversifiée et varie beaucoup d’une nation à une autre, explique-t-elle. Si tu veux connaître la culture d’une Première Nation, d’un Inuit ou d’un Métis, tu regardes le territoire qu’il habite, pis c’est ce que sera son garde-manger.
Pour sa part, elle vient d’une nation de chasseurs-cueilleurs. Ainsi, dans sa communauté, l’alimentation traditionnelle était principalement composée de viandes et de graisses animales; elle contenait très peu de glucides.
Avant l’arrivée de la farine [par l’entremise des colonisateurs], il n’y avait pas de pain, de biscuits, même le sucre provenait surtout des bleuets, des canneberges, des mûres arctiques qu’on appelle les chicoutais, ajoute-t-elle. [L’accès] aux aliments était vraiment restreint, et tu mangeais selon les saisons.
La colonisation a grandement bouleversé les habitudes alimentaires des communautés autochtones. Melissa Mollen Dupuis mentionne d’ailleurs que, dans l’histoire innue, on parle d’époques d’avant et d’après la farine. Pour mieux connaître cette version de l’histoire, on peut approfondir nos connaissances de toutes sortes de façons.
Après la farine...
Dans notre épisode, on parle entre autres de l’impact de la sédentarisation forcée sur l’alimentation des différentes communautés. Contre leur gré, de nombreuses familles ont délaissé les aliments traditionnels. Or, la consommation accrue d'aliments ultra-transformés et de boissons sucrées a entraîné une augmentation importante des maladies chroniques non transmissibles, comme le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires.
À ce sujet, Melissa Mollen Dupuis raconte ses questionnements récents à propos des habitudes alimentaires de sa communauté. Quand on était jeunes, ça n’existait pas, l’éducation alimentaire, parce que dans nos têtes d’Innus, la nourriture, c’était toujours bon, dit-elle. Mais avec la sédentarisation forcée et la production industrielle de nourriture, elle est devenue moins bonne. […] Aussitôt qu’on a été mis dans des réserves, qu’on nous a empêché d’aller sur le territoire, en plus de la transformation intense de l’alimentation, cela a eu tout un impact sur ma génération. On a beaucoup de diabète de type 2 et d’obésité.
Prendre le temps de s’éduquer
Sur OHdio, le balado Laissez-nous raconter l’histoire crochie(Nouvelle fenêtre) est un très bon point de départ. Réalisée par Brad Gros-Louis et Karine Lanoie-Brien, la série est animée par Marie-Andrée Gill. À chaque épisode, des intervenantes et des intervenants issus de différentes communautés autochtones décolonisent l’histoire un mot à la fois.
Un des épisodes porte sur la bannique. Il est question d’ingrédients, de méthodes de cuisson, et aussi d’aspects plus sacrés de ce pain, comme les notions de partage et de survie. On parle aussi des origines de la bannique et des ingrédients blancs apportés par les colons : le sucre, le sel, la farine et la graisse.
De plus, l’Université de l’Alberta offre gratuitement le cours Indigenous Canada(Nouvelle fenêtre) (en anglais seulement). Son objectif est de présenter l’histoire générale de quatre nations — Inuit, Nehiyawak (Cris), Kanien'keha:ka (Mohawks) et Tlingit (Côte Nord-Ouest pacifique) — pour montrer comment elles diffèrent d'un endroit à un autre sur le territoire. Conçu en 12 leçons, le cours est offert en ligne, et il est tout à fait possible de le suivre à son rythme. Au fil du cursus, il est souvent question de culture culinaire.
Lire davantage de livres d’autrices et d’auteurs autochtones permet aussi de s’instruire à propos de cette culture au sens large. Cela tombe bien puisque la campagne En juin : je lis autochtone est en cours et que Radio-Canada présente plusieurs recommandations de lectures provenant d’auteurs, d’autrices, de poètes et d’artistes autochtones de partout au pays.